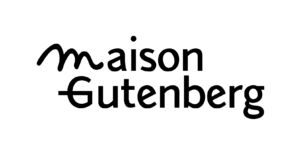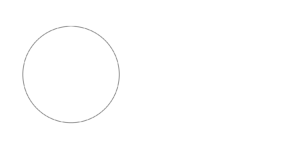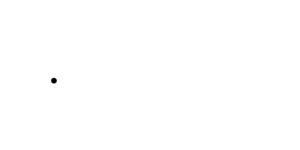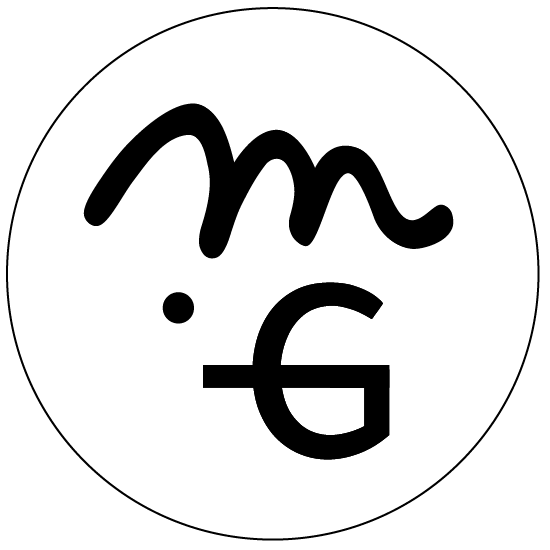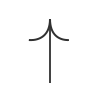© Le grand rocher de Laurent Pernot, photo de Lionel Rault
L’art contemporain revendique de nos jours une porosité significative face aux enjeux sociétaux et environnementaux. Il encourage la prolifération de travaux artistiques imprégnés d’une nécessité de compréhension et de réflexion sur la planète que nous habitons, et, à fortiori, que nous malmenons. Naissent alors des formes d’art sensibles aux problématiques environnementales, un art dit « écologique », un art de combat, pour prendre les termes de l’historien de l’art Paul Ardenne. Un art, pour lequel notre équipe s’engage dans les projets qu’elle mène.
Mais alors que pourrait l’œuvre face aux ravages des dérèglements climatiques actuels ? Gaspillage des ressources, pollution des sols, activité humaine désorganisatrice de la vie de nos environnements…. Inspiré par la nature, habité par la question de la prise de conscience, préoccupé par les enjeux environnementaux, décidé à faire corps avec le dehors — un nouveau courant a éclos, désertant au passage les lieux institutionnels d’exposition pour s’immerger dans l’espace public, du dessous, ou du là-haut, pourvu que l’œuvre appelle à une mise en valeur d’une réalité brute.
Cette question est celle à laquelle se frottent des centaines d’artistes plasticiennes et plasticiens, désormais investis d’une mission de sensibilisation dans un monde où l’actualité nous rappelle chaque jour combien l’humain est coupable des grands désordres écologiques qui secouent notre planète.
Des interventions in situ
Ce mouvement s’inspire du courant appelé « Land Art » né à la fin des années 1960, qui sort alors l’artiste de l’atelier pour le fondre dans le paysage et l’y faire travailler in situ. Mais plutôt qu’utiliser la nature comme simple outil de travail, un glissement progressif s’opère — accéléré par la prise de conscience écologique. L’artiste concentre dès lors son attention vers des travaux visant davantage au soin d’une nature en péril…
Naît alors une culture de l’attention au réel. Le spectateur et l’artiste sont placés dans le paysage plutôt que devant — littéralement « entrer dans l’œuvre » comme l’illustre le travail photographique de Giovanni Anselmo. Bienvenue dans un temps où l’homme et le vivant ne sont plus opposés, mais illustrent par l’art une étroite collaboration, et rendent ensemble visibles les manifestations anthropocènes invisibles.
D’aucuns auront peut-être déjà croisé Bee’s bunker, l’œuvre fonctionnelle et poétique de Nicolas Floc’h — qui installe dans une clairière du massif de Marcaulieu huit blocs de pierre transformés en habitats-forteresse pour des colonies d’abeilles noires. Ou la série de jardins actifs de Patricia Johanson — Leonhardt Lagoon — achevée en 1985, tributaires de la situation écologique, topographique et biologique du milieu. Les installations développées à partir d’un mortier minéral de Jérémy Gobé, l’œuvre complète de l’artiste cueilleur Adrien Mesot, le sanctuaire de la nature installé par Herman de Vries, ou quand le corps nu de l’artiste devient aussi objet d’art avec Alan Sonfist, jusque dans la ferme urbaine de Saint-Denis… en sont des exemples probants de l’histoire de l’art contemporain.
Mais plus proche de nous, du côté du Pays de L’Arbresle, se concentre depuis l’année 2021 un vivier riche de quelques-uns de ces artistes plasticiens et plasticiennes, parfois devenus scientifiques, planteurs et planteuses, ou aménageurs d’espace en quête de relations harmonieuses avec l’environnement — qui progressent dans la bataille pour l’écologie et l’écosophie* (concept du philosophe Arne Næss). À travers le projet des Murmures du Temps sous la direction artistique de Maison Gutenberg, il et elles sont onze à créer in situ dans une perspective de réparation et de redéfinition de nos rapports entre humanité et écosystèmes.
* Arne Naess est à l’origine du concept d’écosophie ou d’écologie profonde. Selon lui, l’Homme et la Nature sont indissociables. « L’homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s’inscrit au contraire dans l’écosphère comme une partie qui s’insère dans le tout ».
Tout le monde dehors
Le parcours pédestre des Murmures du Temps inauguré les 6 et 7 juillet 2024, invite les promeneurs et promeneuses à comprendre comment ces espaces, modifiés, domestiqués, peuvent aussi recevoir soin et attention. On découvrira par exemple l’œuvre tressée d’Amandine Guruceaga — artiste plurielle qui se joue des frontières entre l’art et l’artisanat, l’organique et la technique. Ses œuvres questionnent l’histoire socio-économique des matériaux et révèlent la fascination de l’artiste pour la migration des formes et des motifs et de la frontière entre peinture et sculpture. Son travail sur le parcours questionne alors les premières interventions de l’homme sur la nature, notamment par l’action même de segmenter les espaces naturels…
Parfois, le travail artistique est fruit d’un processus dont le spectateur devient partie prenante. C’est le cas de l’œuvre de Caroline le Méhauté, qui s’intéresse à l’extraction minière sur le territoire, développée sur plusieurs siècles, entraînant une pollution des sols par ruissellement des eaux chargées en acide et en métaux lourds. Elle explore le dessous, et part récolter, avec les habitants, cinq roches qui seront analysées, disséquées, agrandies, et exposées sous de grands verres dans une démarche de mémoire de l’invisible.
Plus loin, au Val des Chenevières à L’Arbresle, Laurent Pernot met en garde l’humain face au risque accru d’aléas climatiques. Façonnée par des conditions météorologiques depuis plusieurs siècles, la nature a ici éprouvé des événements qui ont marqué la mémoire des habitants ; les rivières de la Brévenne et de la Turdine ont débordé à plusieurs reprises, provoquant de terribles ravages sur les communes. Laurent Pernot propose une sculpture dont la silhouette, suggérant une érosion par les eaux, manifeste cette fragilité indéniable.
Sur la place Sapéon, toujours à L’Arbresle, les réflecteurs du designer Nathanaël Abeille installés sur une colline au nord, ont pour mission de renvoyer des rayons du soleil qui colorent et éclairent les façades du quai des Frênes d’ordinaire privées de lumière naturelle à cause de l’urbanisation.
Il arrive que le geste artistique se décale en geste scientifique. La sculpture, portée par le Duo Evernia — composé de Julie Escoffier, artiste plasticienne, et d’Héloïse Thouément, ingénieure chercheuse en chimie — articule art et science sur le parcours. Cette dernière, pensée comme une ode au travail de la vigne, propose de porter attention à la préservation des sols. Elle souligne l’acidité des eaux de pluie lyonnaises, questionne les différentes pratiques de traitement de la vigne à travers des transformations d’ordre chimiques, physiques et biologiques dans une sculpture évolutive, qui fait plus largement écho au territoire naturel, culturel et industriel local.
L’actuel marasme écologique motive la sphère culturelle à s’engager, à réagir, à se faire l’écho d’un désordre global. Car qui, sinon les artistes, experts en sensibilités, pour développer d’autres rapports au monde ? Ce lien entre esthétisme et fonction — qui forme parfois la base de la création plastique — créé avec ce que la nature offre, tout en engageant avec elle un dialogue. Ces œuvres de l’art contemporain qui pensent les évolutions du monde motivent alors l’usage du terme « anthropocène », et nous motive, nous, public, à nous engager aux côtés de celles et ceux qui les conçoivent.
— Article écrit par Louise Grossen pour Maison Gutenberg
Pour aller plus loin